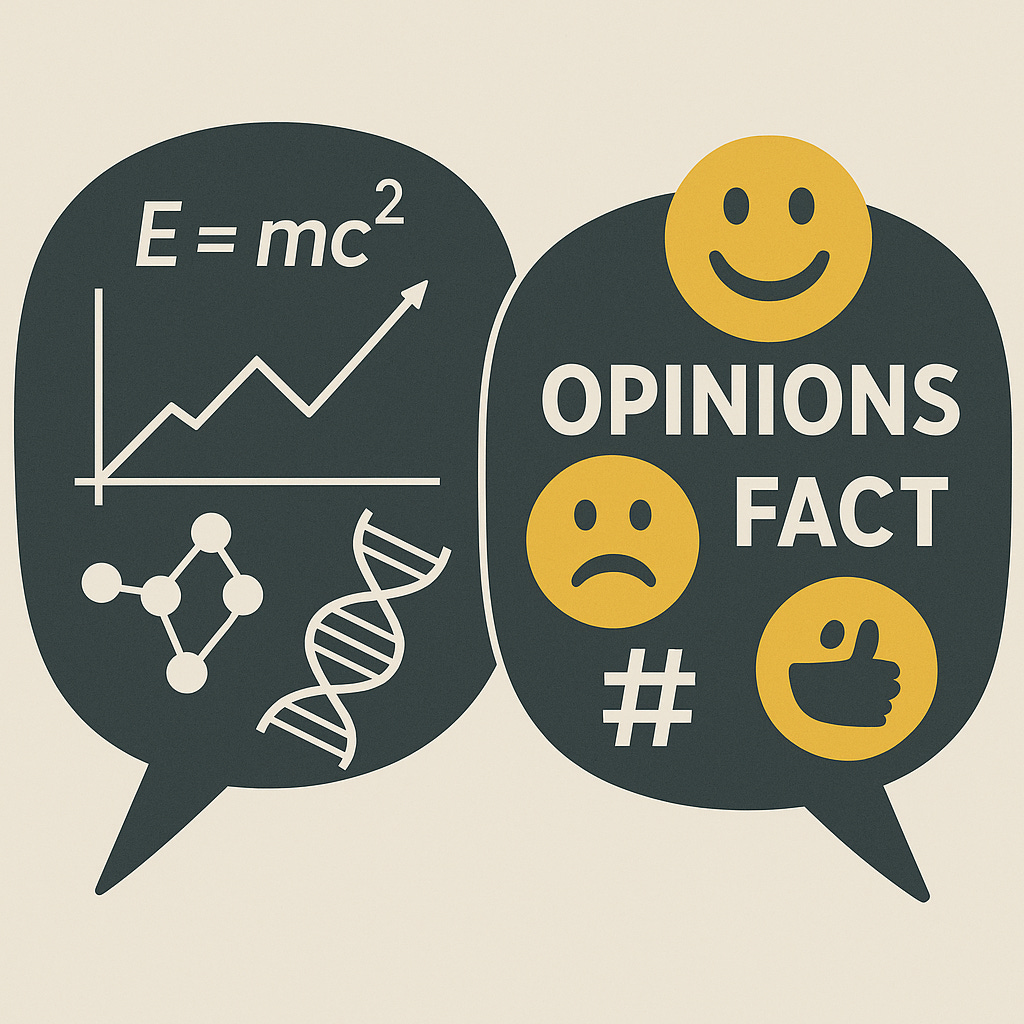Ce que l’échec de la vulgarisation scientifique révèle de notre société
On pourrait croire que la science n’a jamais été aussi présente dans nos vies : médecine de pointe, technologies omniprésentes, alertes climatiques… Pourtant, malgré la multiplication des moyens de diffusion — livres, conférences, vidéos, réseaux sociaux —, la vulgarisation scientifique échoue à toucher la majorité des citoyens. Cette difficulté n’est pas seulement un problème de communication : elle dit quelque chose de profond sur notre société contemporaine.
Une société qui parle aux convaincus
La vulgarisation fonctionne… mais presque exclusivement auprès d’un public déjà intéressé. Conférences, chaînes YouTube et articles touchent une minorité motivée, souvent déjà familière des codes scientifiques. La majorité reste à l’écart, soit par indifférence, soit à cause d’un rapport traumatisé à l’enseignement des sciences à l’école. Cette fracture reflète une société segmentée, où l’accès au savoir dépend autant des prédispositions culturelles que des outils disponibles.
Une société qui confond savoir et opinion
Dans de nombreux sondages, face à une question technique à laquelle personne ne peut factuellement répondre, rares sont ceux qui disent « je ne sais pas ». Nous vivons dans une « société d’affects », où exprimer un avis — même non informé — est devenu un acte de légitimité en soi. Cette posture traduit une difficulté collective à hiérarchiser la valeur des discours : celui de l’expert n’a plus de statut particulier par rapport à celui de l’opinion spontanée.
Une société façonnée par l’instantanéité médiatique
La crise sanitaire de 2020 aurait pu être une leçon magistrale de science en direct : expliquer la courbe exponentielle, la différence entre corrélation et causalité, la signification des essais cliniques. Au lieu de cela, les médias ont souvent privilégié le débat spectaculaire, opposant des invités choisis pour leurs désaccords. Cette préférence pour la polémique rapide au détriment de l’explication patiente reflète une culture médiatique où l’audience prime sur la transmission de savoir.
Une société qui confond science et recherche
La confusion entre science (corpus établi de connaissances robustes) et recherche (activité exploratoire soumise à l’incertitude) a nourri l’idée que la science elle-même n’était que doute et désaccord. Ce brouillage est révélateur : notre rapport collectif au savoir est devenu instable, plus sensible aux controverses qu’aux acquis solides.
Une société qui s’éloigne de la technique
Au XVIIIᵉ siècle, on pensait que comprendre la technique permettrait de comprendre la science. Aujourd’hui, la technologie est un « produit masquant » : plus un objet est sophistiqué, plus il est conçu pour être utilisé sans que l’on ait besoin d’en comprendre le fonctionnement. Ce confort renforce l’idée implicite que la compréhension scientifique est facultative — un symptôme d’une société de consommation qui privilégie l’usage au savoir.
Une société fragmentée en communautés fermés
Le numérique permet à chacun de s’enfermer dans des groupes partageant ses opinions, croyances ou intérêts. Ces « tribus » se définissent parfois plus par opposition aux autres que par recherche de vérité commune. Ce phénomène, déjà décrit par Tocqueville comme un risque pour la démocratie, mine aujourd’hui la possibilité d’un espace public fondé sur des faits partagés.
Conclusion
Les limites de la vulgarisation scientifique révèlent une société qui valorise la rapidité plus que la précision, l’avis plus que la connaissance, et le confort d’usage plus que la compréhension. Si l’on veut inverser cette tendance, il faudra repenser non seulement la manière dont on parle de science, mais aussi la façon dont on les enseignent à l’école ainsi que la place que notre culture accorde au savoir dans la vie démocratique. La question n’est pas plus : « comment mieux vulgariser ? », mais : « quelle valeur collective sommes-nous prêts à accorder à la vérité ? »